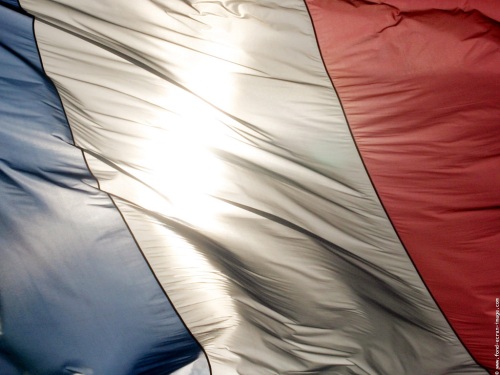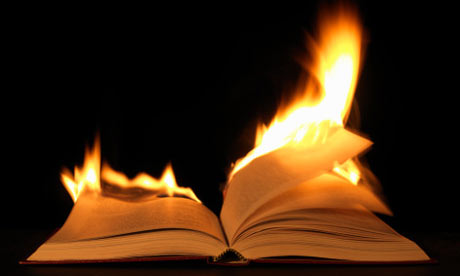Dernières volontés citoyennes (Lettre ouverte à M. Hollande)
Cher monsieur le Président,
En tant que citoyen français et donc cible potentielle, au cas où je serais victime d’un futur attentat _ abattu en terrasse le muscadet à la main, spectateur d’un concert, ou directement sur scène (idéal pour une carrière posthume) ; veuillez considérer cette lettre ouverte comme ma propre oraison funèbre, à titre préventif. Dès lors, inutile d’en confier la rédaction à l’une de vos fines plumes, je préfère m’en charger moi-même. En effet, j’ai toujours eu quelques réserves quant à affilier ma condition humaine, vie et mort, à une cause prétendue supérieure, du type nation ou religion. Ce qui tombe plutôt mal pour un défunt hypothétique tué à cause de l’une, et au nom de l’autre.
Surtout n’y voyez aucune prétention malvenue de ma part. Certes, mes chances de mourir dans un attentat perpétré sur le sol français restent faibles, comparées au risque d’y crever de pessimisme, de renfermement sur soi, ou d’un ulcère foudroyant après 72h de flashs infos. Mais comme ça ne peut pas toujours arriver qu’aux autres, vous me permettrez j’espère, cette projection un rien macabre.
Tout d’abord, je dénie à quiconque en dessous du rang divin le droit de me faire porter l’étendard, sanglant ou non, de la patrie en danger. Vous n’êtes pas le premier à dicter votre bonne parole aux morts _ c’est même une vieille tradition étatique, mais lorsque les victimes se font déchiqueter en uniforme civil, l’hommage rendu ne saurait être confondu avec celui accordé aux nobles serviteurs de la nation, soldats, policiers, ou gendarmes. Nous n’avons simplement pas le même seuil d’allégeance au drapeau, à la défense des intérêts du pays. Cela n’empêche pas le sentiment de citoyenneté, ni peut-être d’avoir le civisme en bandoulière, néanmoins cher président : quel décret spécial vous autorise à épingler autant de symboles républicains sur des couronnes funéraires sans droit de réponse, de réserve, ou de nuance ?
Même en des termes assez neutres pour ne choquer personne, je n’ai aucune envie qu’on prête un sens exacerbé à mon choix parfaitement individualiste d’aller voir un concert, un match de foot, ou boire une bière. Encore moins d’être catégorisé par tranche générationnelle sous la plume paresseuse de quelques éditorialistes, toujours prompts à coller un label sociologique sur ce qu’ils méconnaissaient encore hier. Imaginez les gros titres d’ailleurs, si l’on avait mitraillé une rangée de séniors en plein récital baroque. « Génération Philarmonie », personne ne l’aurait osé sans doute.
Les morts ne seront jamais libres, égaux et frères, encore moins sous les feux de l’actualité. Malheur aux presque-anonymes surtout, car en terme de postérité, la plupart se contentent d’une nécro télégraphique, bien trop sélective. Or ce qu’ils pensaient du conflit syrien, de l’efficience du contre-terrorisme, leur avis sur l’afflux des migrants, sur la protection des frontières, n’interférait pas avec leur agenda loisirs d’un vendredi soir. Ni leur position concernant la défense des libertés individuelles. D’où ma volonté d’anticiper le pire, tout en clarifiant mes opinions, au cas où l’on enclencherait d’autres conflits en mon modeste souvenir, et voterait de nouvelles lois d’urgence, sous prétexte de rendre justice.
Car avant tout, je refuse de voir ce pays qui m’honore, me pleure, sombrer dans un repli identitaire forcené, afficher une mémoire aussi courte que parcellaire. Pour mes obsèques, veillez donc à remplacer le livret de condoléances par une encyclopédie de l’histoire française à feuilleter. Rappelons-nous qu’un peuple si notoirement chaotique et torturé, n’a aucun besoin d’apport extérieur pour se faire du mal à lui-même. Rien que la somme des victimes liées au sanglant épisode de la Commune de Paris, en 1871 (8000 citoyens réprimés par l’armée aux ordres de Versailles), suffirait à remplir quatre Bataclans entiers. Et je ne vois pas en quoi repousser préventivement des hordes de réfugiés à la mer, protégera mes concitoyens de leur propension naturelle à ne jamais être d’accord avec le voisin ; que ce soit à travers une révolution, un conflit territorial, ou concernant le choix des 23 bleus au prochain Euro de football…
Je vous épargnerai mes considérations géopolitiques par contre, monsieur le président. Bien sûr je n’en pense pas moins, mais de nombreux experts à hashtag nous expliquent déjà comment combattre Daech via facebook ou twitter. Une remarque pourtant me titille l’intellect : quand votre premier ministre interprète les attentats du 13 novembre comme une attaque directe envers « notre mode de vie français », feint-il d’ignorer que notre pays mène la guerre depuis des années sur plusieurs fronts, et qu’il reste un des plus grands exportateurs d’armes au monde ? Si l’unique visée des terroristes est notre dépravation occidentale, je suis prêt à trinquer chaque soir en pleine rue, entouré par dix créatures mini-juppées, seulement je doute que cette forme de résistance suffise.
Mais à supposer qu’une poignée d’égarés fanatiques puisse convertir notre mal-être hexagonal en soudaine revendication d’être français, le sujet mérite au moins que tout citoyen adulte aborde franchement la question : d’où vient ce sentiment d’appartenance, pourquoi et comment se déclare-t-on d’ici ? En l’occurrence, brandir son état-civil ou son arbre généalogique, constitue la plus plate des réponses à mes yeux. Pour autant j’accepte l’idée d’une conscience nationale, tant qu’elle ne se prétend pas innée, mais bien comme une identité à saisir, ressentir, et forcément altérer. Une identité réappropriable donc. Naître ne suffit pas, il faudrait devenir français, jusqu’à savoir en définir le caractère.
Or à cet exercice, peut-être en viendrais-je à m’auto-destituer moi-même de ma nationalité. Car devant la francophilie sincère d’un travailleur immigré, bercé par nos sirènes républicaines et leur rayonnement outre-frontières, j’en éprouve une certaine gêne parfois à exprimer si peu de fierté du sol, ayant grandi et vécu en France, bénéficié de ses institutions, de son système de solidarité, tout en m’imaginant régulièrement ailleurs.
On l’aime ou on la quitte, paraît-il. Tel n’est pas votre crédo présidentiel, je sais. Pourtant l’éclatante simplicité du slogan m’est toujours apparue comme un flingue, non seulement pointé sur l’immigrant, le non « de-souche », mais aussi vers ma propre tempe d’apatride frustré, peu réceptif aux levers de drapeaux, pas davantage au redoublement des Marseillaises cathartiques. Et cependant je reste. Pareil à un chercheur d’identité craignant d’avoir négligé une pièce avant de restituer les clefs de la maison. Or ce tour hexagonal du propriétaire, à force de prolongations, m’aura finalement plus enrichi que découragé, m’enjoignant à dépasser l’affect, à contourner une liste purement binaire de « j’aime – je n’aime pas » voués à sa mère patrie. Ni amour, ni haine au fond. Pas plus maintenant qu’avant un 7 janvier ou un 13 novembre 2015, un 21 avril 2002 ou une élection régionale récente. Mais d’abord une vraie fascination envers ce pays totalement schizophrène, imprévisible, génial et honteux au même instant.
Car accepter son appartenance nationale implique d’en mesurer tous les extrêmes, notamment à travers sa dualité historique. De l’Inquisition aux Lumières, l’éventail chronologique est tellement large. On ne saurait arborer fièrement 1789, sans rappeler la Terreur 4 ans plus tard. Célébrer Austerlitz sans mentionner Waterloo, ou inversement. Honorer la Résistance pour mieux relativiser Vichy… Glorifier le Zidane de la finale 98, puis blâmer celui de 2006, coupable d’un geste tellement « gaulois » pourtant. Non justement, il faut tout prendre, tout porter. Et vous en conviendrez, cette histoire pèse une montagne en assimilation. Alors ne m’en voulez pas si je préfère le terme de « société française », à celui de patrie ou de nation. Même « peuple » me semble d’un autre siècle, parlons plutôt du « genre français ». Et parlons « vivre ensemble » plutôt que « mourir ensemble ». En d’autres époques oui, peut-être aurais-je pu défendre ce drapeau par les armes ; aujourd’hui il me semble à l’honneur même de chaque « tombé pour la France », que de libérer cette notion d’appartenance des entraves qui précisément obligeaient un peuple, une jeunesse, aux guerres incessantes, aux luttes souvent fratricides.
Mais vous ne lirez pas ce texte évidemment. Trop long d’ailleurs, en tant que dernières volontés d’un seul citoyen. Nettement moins bavard pourtant que ce débat interminable autour d’une déchéance de nationalité, si symbolique, qu’une fois passé le choc et l’émotion, même le prétexte démagogique de suivre les sondages ne saurait justifier un tel gaspillage du temps politique, médiatique et parlementaire.
Alors en attendant que m’arrive peut-être malheur, je vais continuer à croiser soldats et policiers de façade, en prenant mon métro à la gare voisine. Me faire sommer d’entrouvrir ma sacoche pour la énième fois _ en toute courtoisie bien sûr, mais en totale inefficacité sécuritaire ; conscient de sacrifier une once de vie privée, de liberté, au profit d’une majorité invérifiable de Français que ce maintien en « état d’urgence » rassure, paraît-il. Et avec un peu de chance, je devrais même passer entre les balles jusqu’à l’échéance 2017. Inutile de vous dire que vous serez attendu au tournant. Mais d’ici là, en toute cordialité républicaine, bon courage.
Jullian Angel
(Chanteur-musicien-auteur)
PS : Prière d’éviter tout hommage musical sollicitant une ou plusieurs vedettes françaises. En cas de présence inopportune de monsieur Hallyday, sachez que mon cercueil sera piégé à l’arsenic.